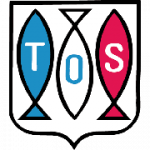Végétations rivulaires et ripisylves , un rappel de leur importance .
par JP Hérold

Le terme de ripisylve désigne étymologiquement la forêt (sylve) de rives (ripa) d’un cours d’eau. Mais en pratique la ripisylve peut former un liseré végétalisé étroit ou un corridor très large, elle peut aussi avoir été supprimée au profit des cultures ou des prairies de fauche. Elle a été modifiée, transformée au gré des besoins des riverains qui cherchent du bois de chauffage ou bien lors des crues violentes qui arrachent et transportent la végétation, créant des embâcles qui modifient les courants. Elle peut, aussi, être maîtrisée au profit des voies sur berges ou chemins de halage. Elle est aussi l’objet d’opérations de restauration par des syndicats de gestion ou des communautés de communes qui en ont la responsabilité.
Il s’agit donc d’un système dynamique avec des périodes de crises et des temps de stabilité qui voient l’installation d’une végétation qui peut paraître permanente.
Cet ensemble de formations boisées, buissonnantes ou herbacées est présent sur les rives des cours d’eau ; la notion de rive désignant le bord du lit mineur non submergé à l’étiage. Selon son type d’évolution naturelle ou provoquée par des aménagements on trouvera toutes les séquences possibles entre le talus abrupt, la grève en faible pente, ou même la plage fréquentée par les bovins ou les humains, et l’existence d’une végétation qui forme un rideau infranchissable pour accéder à la rivière. Une forêt galerie encore plus développée constitue parfois une composante majeure dans un paysage.
Une enquête botanique montre la persistance d’espèces autochtones, aulnes, frênes et saules, bien présents formant la strate arborée commune qui peut être complétée d’érables, noyers, voir pommiers ou cerisiers sauvages et aussi peupliers ou conifères de plantation. Elle est associée à d’autres espèces formant la strate buissonnante composée de plusieurs dizaines d’espèces : noisetiers, sureaux, fusains, troënes, et cornouillers par exemple. Certains secteurs montrent une occupation linéaire remarquable par les roseaux , qui sont le refuge d’oiseaux devenus rares comme la rousserolle turdoïde.
Mais on observe aussi le développement d’espèces allochtones, invasives ou non, aux différents niveaux des strates végétalisées.
Citons pour exemple : l’Erable negundo, la Renouée du Japon, les Buddleias , la Balsamine des marais, les Asters, Solidages et Vergerettes, toutes espèces xénophytes qui forment des franges tampons très évolutives . S’y ajoute depuis peu l’ambroisie à l’origine d’allergies respiratoires pouvant être très graves, donc un problème de santé publique identifié.

La ripisylve est indispensable au bon fonctionnement de la rivière :
Ses rôles sont multiples :
Protection des berges contre l’érosion :
L’enracinement profond des arbres et des arbustes forme un réseau solide. Les racines de certains arbres fixent mieux que d’autres le sol des berges, limitant ainsi les effets de l’érosion.
Toutes les essences d’arbres ne sont pas adaptées : ainsi le Peuplier sera à éviter en bordure de cours d’eau. En effet, il a tendance à développer des racines superficielles et sera rapidement déstabilisé par la rivière en crue, contrairement au Saule, à l’Aulne ou au Frêne, qui ont un enracinement en profondeur, donc résistant aux courants violents. Des opérations de bouturage de tiges de saules pour former des fascines est un moyen peu coûteux pour protéger les rives menacées d’érosion.
Des espèces nouvelles se sont implantées et répandues, elles modifient la fonctionnalité du système rivulaire et perturbent la dynamique des peuplements. Les cas du Buddleia et de la Renouée du Japon, sont exemplaires de leur capacité de colonisation du lit majeur des cours d’eau et aussi du lit mineur lors des périodes d’années sèches. Des travaux d’extraction s’avèrent parfois utiles sur des zones d’atterrissements pour laisser passage au débit de crue et limiter ainsi les inondations.
Ralentissement du courant : la ripisylve offre des obstacles à la rivière et à son débit, elle dissipe ainsi la force du courant, limitant l’érosion excessive. La puissance hydraulique engendrée par la rivière est en évolution permanente au cours d’un cycle annuel : sans ce rôle de régulation, cette énergie serait reportée ailleurs ; pendant les crues, les végétaux rivulaires freinent l’eau, ils brisent le courant et protègent les berges aval d’une érosion trop forte. Les embâcles sont souvent des abris pour la faune aquatique, dont les poissons de grande taille. Mais trop d’obstacles, en particulier cette végétation qui se développe dans le lit mineur en période d’étiage amplifient les effets de crues dévastatrices lors des accidents météorologiques dont la fréquence augmente.
Le processus d’hydrochorie : transport par l’eau de graines, boutures, rhizomes contribue à la dispersion des espèces végétales et à la recolonisation de secteurs brutalement modifiés par des travaux hydrauliques ou des crues violentes, le budleia et la renouée en sont des exemples marquants. Les annexes du lit principal de la rivière sont les zones où l’évolution de la végétation est la plus visible et la plus rapide. En cinq ans, un milieu humide inondable, laissé en libre cours, est transformé en taillis impénétrable à l’origine d’une nouvelle ripisylve.
Zone tampon, épuration et fixation des intrants des terres agricoles : les végétaux, le sol et ses microorganismes constituent un filtre naturel pour les pollutions qui migrent en direction de la rivière.
Les nitrates, les phosphates et les molécules phytosanitaires sont fixés par les composants pédologiques, dont les argiles, puis sont dégradés par les microorganismes, mycorhizes et bactéries, ce qui évite ainsi leur rejet direct dans la rivière.
La bande enherbée qui doit être respectée sur une largeur de 5 mètres, selon la réglementation actuelle, est encore insuffisante pour une efficacité optimale. Les végétaux rivulaires qui prélèvent les matières organiques et minérales de l’eau de la rivière participent ainsi à une auto-épuration naturelle. Les bactéries associées aux diatomées, algues, éponges et mycorhizes sont efficaces dans un processus dont on sous-estime le rôle.
Zone ressource et de refuge : La ripisylve est un lieu de ressource de nourriture, un lieu de reproduction, de refuge et de vie pour de nombreuses espèces animales, végétales, terrestres et aquatiques. Les espaces en sous-berges, cavités et anfractuosités ou les racines des saules et des aulnes, sont alors des abris pour les poissons et les crustacés comme les écrevisses ou les caridines. Les » froidières » sont les refuges des salmonidés lors des épisodes de canicules, ce sont des sources discrètes dans le lit mineur du cours d’eau souvent cachées sous la végétation de rive, en communication avec la nappe phréatique dont l’eau est à une température plus basse. On ignore encore trop ce lien entre les eaux de nappe et celles courantes dans la rivière. L’ensemble constitue un système complexe qui est bien plus varié que celui d’un lit majeur aménagé et traité en monoculture.
La diversité biologique est forte dans ces franges souvent laissées à l’abandon et que certains exploitants agricoles appellent encore à tort des friches, des « laisses » ou des « mortes » inutiles !
D’autres fonctions sont identifiées :