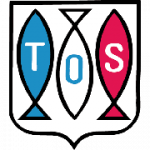Les populations bretonnes de saumon atlantique semblaient jusque-là relativement à l’abri des difficultés majeures. Même si nous étions loin de l’abondance passée, même si des événements de pollutions « accidentelles » se faisaient régulièrement et lourdement sentir, même si le Blavet et l’Aulne étaient laissés dans l’incapacité d’exprimer leur plein potentiel, les populations se maintenaient dans l’ensemble.

Les outils de suivis quoique sous-dimensionnés (on regrette par exemple le manque de stations de comptage, seulement trois cours d’eau en étant pourvus !) permettaient néanmoins d’envisager un avenir dans la continuité, à défaut d’être brillant. L’indicateur le plus régulier à l’échelle régionale restait celui des indices d’abondances en juvéniles, un marqueur de la qualité de la reproduction et des capacités de production du milieu. Le poisson fait même l’objet d’un pôle d’étude spécialisé en Bretagne à la station INRAE du Moulin des Princes près de Pont Scorff (56), sur la rivière éponyme, le Scorff servant ensuite de point de référence régional. L’ensemble des données scientifiques et techniques est compilé par Bretagne Grand Migrateurs qui met ses rapports et publications à disposition du public sur son site . L’ensemble des décisions de gestion des stocks est élaboré en COGEPOMI et, pour celles qui sont réglementées par un arrêté préfectoral, soumises à la consultation du public
Ces dernières années des acteurs associatifs, dont ANPER mais aussi quelques AAPPMA locales ont interpellé les décisionnaires car les Totaux Autorisés de Captures semblaient déconnectés de la réalité de terrain. On relevait des TAC supérieurs à la quantité de poissons réellement présents en rivière là où ce chiffre était connu. Qui plus est, l’objectif de protection prioritaire des saumons de printemps était ouvertement bafoué, permettant ainsi la capture de la moitié voire plus de ces poissons (à 80 % des grosses femelles). In fine, aucune Limite de Conservation [1] précise n’était définie et l’approche précautionneuse recommandée par l’Organisation de Conservation du Saumon de l’Atlantique Nord n’était pas respectée. Cette problématique a mené en 2019 à l’élaboration du projet RENOSAUM dont le but était de réajuster les TAC en proposant une limite de conservation par bassin, associée à un risque statistique d’atteinte de ce seuil. Les concepteurs du projet avaient clairement pointé le grand écart entre les besoins de conservation et les prélèvements par la pêche aux lignes…
[1] Limite de Conservation = stock reproducteur qui produit le surplus maximum selon l’OCSAN ; définition sujette à discussion notamment pour les stocks faibles, car l’impact des prélèvements peut être très sévère. Selon d’autres données c’est le nombre d’adultes de retour à même d’assurer un nombre de géniteurs équivalent à la génération suivante.