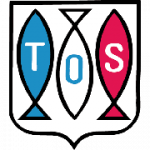C’était l’occasion d’une matelote, ou mieux d’une pôchouse : récompense gastronomique d’un plat emblématique de Verdun sur le Doubs.
Ce plat réunit l’anguille et la tanche deux poissons gras avec le brochet et la perche deux poissons à chair maigre. On peut y ajouter de la carpe, mais tous présentés en morceaux charnus découpés et cuits dans une sauce au vin du Jura. Il y a fort longtemps, c’était le menu des pêcheurs (les pôcheurs ) et des radeliers qui descendaient les radeaux de bois des forêts jurassiennes vers Lyon pour la charpente et la menuiserie.
En Franche Comté, jusque dans les années 1950, les pêcheurs amateurs qui pratiquaient dans le Doubs et la Saône capturaient des anguilles de façon régulière.

réf. Biblio. N°2
JP Hérold, co-auteur des fiches spécifiques.
Une méthode de pêche consistait à poser au fond de la rivière un appât, gros ver ou petit poisson mort, au crépuscule, sachant que l’anguille est lucifuge et active la nuit.
Il fallait patience, persévérance et connaissance des sites fréquentés par cette espèce pour capturer quelques beaux spécimens pouvant dépasser un mètre de long.
Cinquante ans plus tard : plus d’anguilles dans nos rivières !
L’espèce est même inscrite sur la liste rouge de l’UICN, Union internationale pour la conservation de la nature, dans la catégorie « en danger critique d’extinction «
Alors, pourquoi ? Que s’est-il passé ?
Une des raisons de ce déclin réside dans la fermeture des voies de migrations.
En effet l’anguille est un migrateur amphihalin thalassotoque ! en clair : la reproduction se déroule en mer et sa croissance en eau douce, donc d’un milieu à l’autre elle se déplace de la mer des Sargasses, site probable de ponte, vers les côtes de l’Europe soit atlantique , soit méditerranéenne .
Pour arriver en Franche Comté elle remontait le Rhône ; mais à présent la route est coupée par des barrages gigantesques comme celui de Donzère-Mondragon : construit en 1952, il est infranchissable !
Sur les sites de la façade atlantique les barrages de filets aux embouchures des fleuves et les pêches des alevins en migration, les civelles, sont pour des pêcheurs plus ou moins professionnels de revenus notables. Le kilogramme de civelle est vendu une petite fortune, près de 1000 euros à des restaurateurs du sud-ouest et aussi de l’Espagne.
Un plat traditionnel, nous dit-on, mais qui provoque la chute des populations : autant de juvéniles qui ne se déplaceront plus vers les rivières, les étangs et les marais de l’Hexagone pour y prospérer pendant dix à quinze ans.
Donc dans les zones humides et les rivières de l’est de la France : plus d’anguilles !
Reste le marais poitevin ou l’étang de Thau où la pêche est encore pratiquée ….
Or le sujet principal de la récente réunion des ministres européens de la pêche à Bruxelles portait sur le devenir de l’anguille européenne (Anguilla anguilla, Linnaeus, 1758).
Et malgré la proposition des ONG qui demandaient de cesser complètement la pêche, demande relayée par la Commission européenne, la décision est tombée le 13 décembre 2022 au petit matin, après deux jours et une nuit de négociation : le communiqué de presse ministériel précise :
« Le secrétariat d’Etat à la mer s’est opposé aux solutions proposées par la Commission européenne, même s’il partage le constat des scientifiques sur l’état très dégradé des populations d’anguilles »
Il accepte donc de maintenir une activité de pêche adaptée à chaque bassin.
Pour les ONG et les scientifiques les dérogations obtenues viennent annihiler toute protection. Or en 50 ans l’espèce a connu un véritable effondrement avec une baisse de 95% de ses populations. Sans mesures plus strictes leur sort pourrait être scellé.
Fini la pôchouse, adieu l’anguille, foin de la biodiversité !
Qu’en dit la COP 15 réunie à Montréal (Canada) en ce mois de décembre 2022, d’autres sujets encore plus urgents sont à l’ordre du jour, les discussions s’éternisent sur la protection des milieux, et donc la biodiversité attendra ! Même si tout est lié !
JP Hérold, biologiste.
Des références :
- Les Poissons d’eau douce de France. 2011, P. Keith, H. Persat, E.Feunteun, J. Allardi. Publication du Museum d’Histoire Naturelle de Paris, Biotope Edition. 552p.
- La vie en eau douce 2012. JP. Corolla, M. Kupfer, G. Rochefort, S. Sohier, DORIS, Edition Neptune Plongée, 415p.